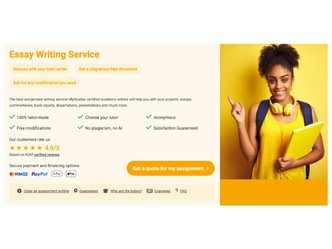Le baccalauréat a été créé en 1808 sous Napoléon Ier et il représente aujourd’hui l’un des principaux fondements du système éducatif en France.
Toutefois, ce diplôme a beaucoup évolué depuis sa création. Dans cet article, nous allons parler de cette évolution depuis les années 90.
Cap sur les changements dans les modalités d’examen, les parcours, la nature des épreuves et les conséquences pédagogiques et sociales de ces transformations.
Le bac dans les années 90
Filières et non spécialités, tronc commun et coefficients
Dans les années 90, l’examen n’était pas axé sur des spécialités, mais sur des filières : générales, technologiques et professionnelles. Contrairement à ce que l’on retrouve aujourd’hui, les filières générales étaient la série L, littéraire, ES, Économique et sociale et S, scientifique. Parmi les séries technologiques, STT, STL, STI, auxquelles s’ajoutaient les filières professionnelles.
Dans chacune des séries énumérées ci-dessus, il y avait un tronc commun avec des matières plus dominantes que d’autres. Les coefficients étaient plus élevés en fonction des matières dominantes.
Épreuves finales vs contrôle continu
A cette époque, il n’y avait presque que des épreuves finales qui étaient passées en fin de Terminale, au mois de juin. Les épreuves anticipées de français, qui se composaient d’un écrit et d’un oral, avaient lieu en classe de première, en juin.
Il n’existait pas de contrôle continu, l’égalité de chaque élève reposait sur le rendu de copies anonymes, chaque candidat avait un numéro d’identification.
Chaque filière avait des coefficients différents, par exemple pour la série S, les maths avaient un coefficient 7, et la SVT un coefficient 6.
Dans les années 90, le programme était plus rigide, avec beaucoup plus de devoirs sur table et la mise en place d’examens blancs.
Le bac depuis la réforme Blanquer
L'avènement des spécialités
L’examen du baccalauréat a beaucoup évolué depuis la réforme Blanquer. Les filières générales des années 90 disparaissent pour laisser la place aux enseignements de spécialités. La réforme a eu lieu entre 2019 et 2021 et les séries L, ES et S que l'on connaissait auparavant, ont disparu au profit d'un tronc commun et d'une série de spécialités qui peut être choisies par les élèves.
Ainsi, les étudiants en terminale vont suivre un tronc commun avec le français, la philosophie, l'histoire-géo, les langues vivantes, le sport, la science et l’EMC. En premier, il y a trois spécialités disponibles, il n'y en aura que deux en terminale. Parmi ces dernières, humanités, littérature et philosophie également appelé HLP, ou encore LCR, Langue, littérature et civilisations étrangères.
Contrairement à ce qui était en place dans les années 90, ce système est plus souple parce que l'élève peut combiner plusieurs spécialités.
Contrôle continu à 40%
Encore une différence, puisqu'à la place de l'examen final au mois de juin, apparaît le contrôle continu qui est l'un des bouleversements majeurs de cette réforme.
Le contrôle continu, cela veut dire que 40 % de la note finale repose sur des évaluations communes et des bulletins scolaires.
Parmi les 60 % restants, il y a les épreuves anticipées de français (EAF) et les deux spécialités qui sont choisis en première et en terminale. On retrouve également l'épreuve de philosophie et le Grand Oral qui fait aussi partie des changements majeurs.
Le Grand oral
En effet, le grand oral a été mis en place pour favoriser l'expression orale, qui n'était que peu présente lors des anciennes sessions. Il s'agit d'une présentation de 20 minutes sur une question initialement préparée par l'élève et qui est en lien avec les spécialités qu'il a choisies. Le jury évalue à ce moment-là, la capacité d'argumentation, et la manière de convaincre de l’élève. Jusqu'à présent, l'examen repos, surtout sur des écrits, le grand oral opère donc comme une sorte de rupture avec une tradition existant depuis des années.
Les objectifs pédagogiques
À la fin des années 90, le baccalauréat était un diplôme qui était une porte d'entrée à l'université ou une grande école. Au niveau pédagogique, les choses changent un petit peu aujourd'hui ou en tout cas, depuis la réforme, puisque le bac devient davantage une aide à l’orientation.
Parcoursup, qui est le moyen de s'inscrire à l'université ou dans une grande école, n'existait pas dans les années 90. Des élèves s'inscrivent en fonction des spécialités qu'ils auront choisies, et des bulletins de notes. Contrairement à ce qu'il en était il y a 20 ou 30 ans en arrière, le baccalauréat devient plus personnel, il prend en compte le profil différent des élèves.
Ainsi, les élèves sont plus responsables quant à leur orientation.
Les limites de cette réforme
S’il y a une critique qui revient assez souvent, c'est le renforcement des inégalités entre les élèves qui est mis en avant depuis la réforme. Par inégalité, on entend celle qui existe entre des élèves mais aussi entre les établissements. Par exemple le contrôle continu accorde une importance considérable à la manière dont les professeurs notent et au niveau de l’établissement.
Tous les lycées en France n'offrent pas les mêmes spécialités et le Grand Oral peut défavoriser des élèves qui se sentent moins à l’aise à l’oral.
En outre, ce nouveau système accompagné de spécialités est parfois plus complexe à comprendre.
Parcoursup n'est pas toujours très bien accueilli par les familles car le système est souvent fermé, mettant une pression supplémentaire sur les épaules des étudiants.
Pour les enseignants, il s'agit de prendre en compte à la fois le contrôle continu et de préparer les élèves aux épreuves finales.
Pour en revenir, à Parcoursup, les élèves doivent s'inscrire sur le site avant même de passer leurs épreuves. Si auparavant, la classe de terminale était la plus importante, on peut se questionner aujourd'hui sur l'importance de la classe de première, puisque c'est à ce moment-là que les élèves vont choisir leurs spécialités.
Comment est perçu le bac aujourd'hui ?
La question que l'on peut se poser aujourd'hui et de savoir ce qu'est véritablement le bac en 2025. Dans les années 90, il s'agissait d'un évènement collectif, qui avait de l’importance. Aujourd'hui, il tend à être moins solennel avec une unification moins prononcée. Pour certains, c'est davantage un moyen de sélectionner les élèves selon leur niveau et leur lycée d’origine, elle n'est donc pas toujours très bien perçue.
Conclusion
Par conséquent, le diplôme du baccalauréat a beaucoup évolué entre les années 1990 et aujourd'hui. S'il était auparavant un diplôme uniforme et solennel, il est devenu un système plus hybride, qui met en avant la personnalisation du parcours.
La réforme a fait de la nature même du diplôme quelque chose de différent. Dans les années 90. Il s'agissait de valider un niveau d'études et de pouvoir s’inscrire dans les grandes écoles et aux universités, le diplôme à lui tout seul marquait une étape dans la vie des jeunes. Aujourd'hui il s'agit d'orienter les élèves vers des filières de plus en plus sélective, et cela n'est pas au goût de tous.
https://www.cours-thales.fr/preparation-bac/pourquoi-la-reforme-change-la-donne
https://eureka-study.com/baccalaureat-historique-et-reformes/
https://www.sudeducation.org/tracts/les-effets-des-reformes-blanquer-sud-education-fait-le-point/


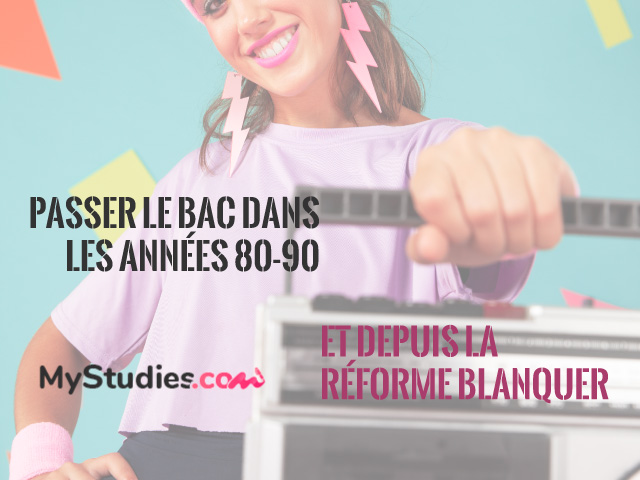






![[Bac EPPCS 2025] - Corrigé : étude de documents - Sujet 2 - faire progresser les sportifs avec les nouvelles technologies](https://www.msnocookie.com/image/ms/msimages/blog_gallery/bac-eppcs-2025-nouvelles-technologies_408f396223_81.jpg)
![[Bac philo 2025] - Corrigé Dissertation - Sujet 2 - La vérité est-elle toujours convaincante](https://www.msnocookie.com/image/ms/msimages/blog_gallery/bac-general-philo-2025-sujet-2_00ffd15760_81.jpg)