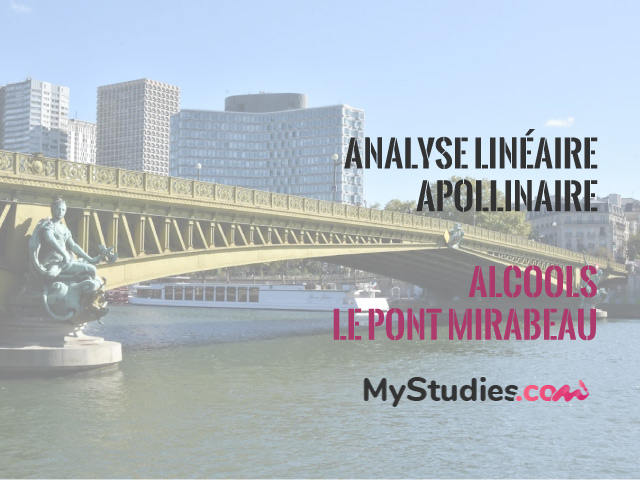I. Premier mouvement : Première et deuxième strophes
Aux vers 1 à 4 : « Sous le pont Mirabeau coule la Seine / Et nos amours / Faut-il qu’il m’en souvienne / La joie venait toujours après la peine », le poète pose le cadre de son poème. Il pose tout d’abord le décor avec les deux références géographiques : celle du Pont Mirabeau et celle de la Seine, qui sont les symboles de la ville de Paris. Ces vers ont une fonction symbolique, celle d’évoquer le temps qui passe au moyen de l’eau de la Seine qui s’écoule. Ce temps qui passe est à relier avec le deuxième vers : « Et nos amours », qui évoque la permanence du souvenir amoureux. Le vers trois est une question rhétorique. Le poète, à travers une question qui n’en est pas une, s’interroge sur la difficulté qu’il a lorsqu’il s’agit d’oublier le passé, notamment une relation qui le fait souffrir. La mélancolie vient d’ors et déjà nimber le poème de son voile sombre. Le poète est alors tourné vers une introspection. Toutefois, cette note triste est gommée au vers suivant : « La joie venait toujours après la peine ». Ainsi, le poète, en évoquant la dualité entre « joie » et « peine », qu’il présente comme deux états indissociables, amène le lecteur ou la lectrice à penser que c’est dans la douleur que naît la joie. La tristesse du poète sera vite évaporée lorsqu’un prochain amour viendra. Ainsi, à travers le motif de l’eau qui s’écoule, symbolisant le temps qui passe, et des cycles amoureux qui laissent s’entremêler tantôt la joie et tantôt la peine, le poète laisse à penser que la souffrance est un des parangons des relations amoureuses, mais que celle-ci laisse place à l’épanouissement, au bonheur. C’est un motif récurrent de la poésie romantique qui est repris ici par Apollinaire.
La deuxième strophe du poème est un refrain que l’on retrouve à quatre reprises à l’identique. Le poète y écrit : « Vienne la nuit sonne l’heure / Les jours s’en vont je demeure ». C’est à travers la répétition de la strophe que le poète fait état du sentiment d’éternité. Il sembler résister au passage du temps. Quant au sens des vers ceux-ci évoquent la nuit sonnant comme l’inéluctable fin. Pourtant, « je demeure » vient s’opposer à cette fin. Si le corps est mort, la mémoire et les émotions du poète demeurent.
II. Deuxième mouvement : Troisième et quatrième strophes
Les vers 7 à 12 viennent faire entrer le lecteur ou la lectrice dans l’intimité du poète :
« Les mains dans les mains restons face à face / Tandis que sous / Le pont de nos bras passe / Des éternels regards l’onde si lasse ». Ici, l’image des mains qui se tiennent donne à voir le poète amoureux en mouvement. L’image est arrêtée par le verbe « rester » qui impose une pause. De fait, on peut opposer cette image de l’amour à la fuite du temps de la première strophe. Le pont Mirabeau devient le « pont de nos bras ». Les amants bâtissent un monument à partir de leur amour solide. Mais « l’onde si lasse » veille sous le pont. Aussi, le poète nous rappelle que l’ombre de la lassitude règne sur l’amour naissant. L’onde emporte tout, même les sentiments du poète, malgré les « regards éternels » qui évoquent la sincérité des sentiments du poète. Ceux-ci ne peuvent durer dans le temps.
Le refrain vient ponctuer ce deuxième mouvement. Cela renforce le côté cyclique du poème.
III. Troisième mouvement : Cinquième et sixième strophes
Dans les strophes 13 à 18, le poète tente de résister à cette idée de l’instant éphémère : « L’amour s’en va comme cette eau courante / L’amour s’en va / Comme la vie est lente / Et comme l’Espérance est violente ». Comme précédemment, l’« eau courante » symbolise la fugacité de l’amour. Il est en mouvement ; il court à sa fin. Pourtant, en opposition à cette brièveté, le poète nous rappelle que « la vie est lente ». Il y a une tension dans la temporalité du poème. La vie lente laisse place à de nombreuses amours. Ainsi, les amours vont et viennent. Comme l’eau, l’amour est insaisissable.
Un troisième refrain vient clore cette spirale du temps qui passe. La répétition du refrain à l’identique comme un éternel retour vient insister sur la permanence du souvenir face à l’éphémère
IV. Quatrième mouvement : Septième et huitième strophes
Les vers 19 à 24 viennent clore le poème : « Passent les jours et passent les semaines / Ni temps passé / Ni les amours reviennent / Sous le pont Mirabeau coule la Seine ». Le temps qui passe est clairement évoqué, avec la gradation « les jours » deviennent « les semaines ». Le temps file à toute allure. La répétition du vers final, juste avant le dernier refrain, répétant le premier vers du poème, insiste sur cet effet de cycle. Le temps s’écoule inexorablement, mais le temps est une spirale qui revient à son commencement, la vie est un enchaînement en naissances et de morts, de renouveau et de fins. Le temps vient s’enchevêtrer dans une continuité ; cette continuité s’appuie sur une répétition des événements.
La structure répétitive du refrain poétique puissant en une formule : « Vienne la nuit sonne l’heure / Les jours s’en vont je demeure » agit comme un refrain, conférant au poème une dimension musicale, proche de la chanson. Cette clausule finale participe à cet effet de méditation poétique mélancolique. C’est l’une des caractéristiques de la poésie moderne.
Conclusion
Le poème "Le Pont Mirabeau" de Guillaume Apollinaire est une œuvre emblématique de la poésie moderniste. Celui-ci vient engager le lecteur ou la lectrice à une méditation sur le temps et l’amour. La structure répétitive du poème invite à une réflexion universelle sur la fugacité de la vie et la permanence de la mémoire. Ainsi, Apollinaire écrit une œuvre poétique puissante, où les émotions sont convoquées à des fins d’universalité : le poète nous dit que le temps fait son œuvre.
Sources et références
APOLLINAIRE, Guillaume, Alcools, NRF, Gallimard, 1913.
LECOMTE, Louis, La poésie moderne, Presses Universitaires de France, 2004.
BENSAÏD, Abdelwahab, Poésie et modernité, Éditions Gallimard, 2010.