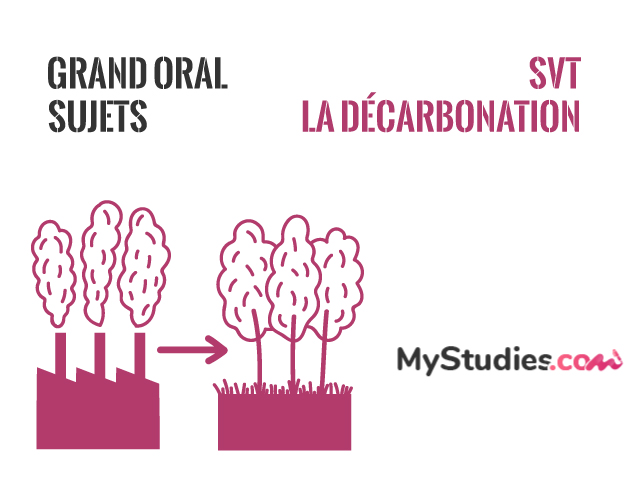Comment préparer et rédiger votre grand oral de SVT sur la décarbonation ?
Première étape : définir le CO2
Le CO2 est la formule moléculaire chimique de la molécule de dioxyde de carbone, composée de carbone et d'oxygène. Le dioxyde de carbone gazeux est incolore, facilement soluble dans l’eau, ininflammable, inodore et non toxique. Avec l'azote, l'oxygène et les gaz dits rares, il est un composant naturel de l'air et compte parmi les gaz à effet de serre les plus importants.
Le CO2 ne constitue qu’une petite partie de l’air, cependant, en tant que gaz à effet de serre, il joue un rôle important dans notre climat : le CO2 absorbe ainsi une partie de la chaleur dégagée par la Terre dans l'espace et la restitue vers la Terre. Cet effet de serre naturel crée le climat tempéré que nous connaissons sur terre, qui permet à la flore et à la faune de prospérer.
Le dioxyde de carbone est présent naturellement dans l'atmosphère terrestre. C'est un sous-produit naturel de la respiration cellulaire de nombreux êtres vivants et il est également produit lors de la combustion du bois, du charbon, du pétrole ou du gaz. Le dioxyde de carbone est par ailleurs libéré lors de la décomposition d'organismes morts ou via des sources naturelles de CO2, telles que les gaz volcaniques.
Le dioxyde de carbone est présent naturellement dans l'atmosphère terrestre. C'est un sous-produit naturel de la respiration cellulaire de nombreux êtres vivants et il est aussi produit lors de la combustion du bois, du charbon, du pétrole ou du gaz. Le dioxyde de carbone est également libéré lors de la décomposition d'organismes morts ou via des sources naturelles de CO2, telles que les gaz volcaniques.
Une fois rejeté dans l’atmosphère, le CO2 ne se décompose pas tout seul, contrairement à d’autres substances. Dans le cadre du cycle du carbone, le CO2 libéré est soit physiquement stocké dans les plans d’eau, soit décomposé par les plantes vertes lors de la photosynthèse. Grâce à la lumière du soleil, le dioxyde de carbone est converti en glucose (qui, en tant que biomasse contenant des glucides, est un matériau de base pour tous les organismes) et en oxygène. L'oxygène est rejeté dans l'environnement. Ces réserves naturelles de dioxyde de carbone sont ainsi appelées « puits de carbone ».
Deuxième étape : expliquer comment les émissions excédentaires de CO2 s'ajoutent à l'atmosphère et ses conséquences sur le climat
Non seulement les processus naturels libèrent du CO2, mais les humains en particulier laissent une importante empreinte CO2 sur la terre. Depuis le début de l’industrialisation, de plus en plus de dioxyde de carbone est libéré dans le monde entier lors de la combustion de charbon, de pétrole brut ou de gaz naturel dans l’industrie ou pour le chauffage. Rien que depuis le milieu du 20e siècle, l’augmentation mondiale du dioxyde de carbone a presque quadruplé. Qu’est-ce que cela signifie pour notre climat ?
Les puits de carbone naturels ne sont pas capables de lier ou de convertir complètement le CO2 supplémentaire généré par l’homme. En conséquence, la proportion de dioxyde de carbone dans l’atmosphère augmente. La première mesure de la densité du CO2 dans l'air a été réalisée en 1958 par le scientifique Charles David Keeling dans une station de mesure. Depuis, plusieurs stations de mesure ont été ajoutées et le résultat est clair : l’enrichissement de l’atmosphère en dioxyde de carbone augmente chaque année.
En raison de l’augmentation des particules de CO2 dans l’atmosphère, de moins en moins de chaleur rayonnée par la Terre peut s’échapper dans l’espace. Les conséquences : le climat de la Terre se réchauffe, les calottes polaires et les glaciers fondent et le niveau de l'eau des océans augmente. Les changements climatiques sont également susceptibles d’entraîner une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur ou les sécheresses. La déforestation des forêts tropicales et le lent réchauffement des océans signifient également que moins de CO2 peut être séquestré de l’atmosphère.
Le lent réchauffement de la température terrestre a un impact majeur sur les conditions de vie des humains, des animaux et des plantes. Surtout dans les régions proches de l’équateur, qui sont souvent des pays en développement, les sécheresses ou les inondations entraînent la perte de récoltes vitales. Ailleurs, des États insulaires entiers sont menacés d’extinction en raison de l’élévation du niveau de la mer.
Le dioxyde de carbone ou dioxyde de carbone (ou CO2 en abrégé) est le gaz à effet de serre le plus important et le plus connu. Cependant, ce n’est pas le seul. Par exemple, le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et les gaz F (gaz à effet de serre fluorés) sont également des gaz à effet de serre importants. Cependant, ils présentent tous des niveaux différents de dommages climatiques ou d’impact climatique, Leur effet de serre est converti en celui du dioxyde de carbone (CO2). La somme des processus climatiques provoqués par exemple par le trafic aérien est exprimée en équivalents CO2.
Documents intéressants à consulter pour approfondir le sujet du CO2 et de la décarbonation :
- Exemple de dissertation : Le marché européen d'échange de quotas de pollution est-il un outil de décarbonisation efficace ?
- Thèse en finance : Le risque climatique sur les actifs financiers
Troisième étape : expliquer la stratégie de décarbonation à long terme
La décarbonation fait référence à l’élimination ou à la réduction de toutes les émissions de carbone d’origine humaine dans l’atmosphère.
La décarbonation est un processus complexe et progressif dans lequel nous cherchons à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO₂) et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La clé du succès réside dans la bonne application d’une stratégie de décarbonation bien planifiée et exécutée.
La stratégie de décarbonatation à long terme s’inscrit dans le cadre stratégique en matière d’énergie et de climat. En Europe, la stratégie de décarbonatation à long terme fixe l'objectif ambitieux de réduire les émissions de gaz à effets de serre de 90 % d'ici 2050, en prenant comme référence les niveaux de 1990. Les 10 % restants devraient être compensés par des mécanismes d'absorption du carbone, tels que la reforestation, qui agit comme des puits de carbone, éliminant le CO₂ de l’atmosphère.
La stratégie de décarbonation à long terme ouvre la voie à un modèle énergétique basé sur des sources renouvelables, qui apporte de multiples avantages :
- Compétitivité accrue : un système énergétique plus efficace et moins dépendant des combustibles fossiles
- Amélioration de la santé publique : la réduction de la pollution atmosphérique associée à la combustion des fossiles a un impact positif sur la santé de la population
- Conservation de la biodiversité : l’atténuation des effets du changement climatique contribue à la protection des écosystèmes et de la biodiversité.
- Hydrogène vert : la solution miracle pour décarboner l'industrie lourde ?
Quatrième étape : expliquer les opportunités de la stratégie de décarbonatation à long terme
La transition écologique promue par la Stratégie de décarbonation à long terme crée un scénario favorable à l’émergence de nouvelles opportunités dans tous les secteurs économiques. Ce processus implique de dissocier la croissance économique de la consommation d’énergie et de l’impact environnemental négatif, en promouvant un modèle de développement durable.
Ci-dessous, nous explorons certaines des opportunités les plus pertinentes offertes par la stratégie de décarbonation à long terme :
- Création d'emplois et investissement : la stratégie de décarbonation à long terme comprend des mesures qui stimuleront la création d’emplois. Les secteurs liés à la numérisation, à la production industrielle durable et aux énergies renouvelables seront les principaux moteurs de cette création d'emplois.
- Attirer les investissements : une mobilisation importante des investissements est attendue. Une grande partie de ces investissements sera allouée à la mise en œuvre de la stratégie de décarbonation et au développement de nouvelles technologies propres.
- Mesures de conservation et de restauration : des mesures sont proposées pour renforcer le capital naturel, comme l'augmentation de la superficie forestière. Ces actions contribuent également à la biodiversité et à la conservation des écosystèmes.