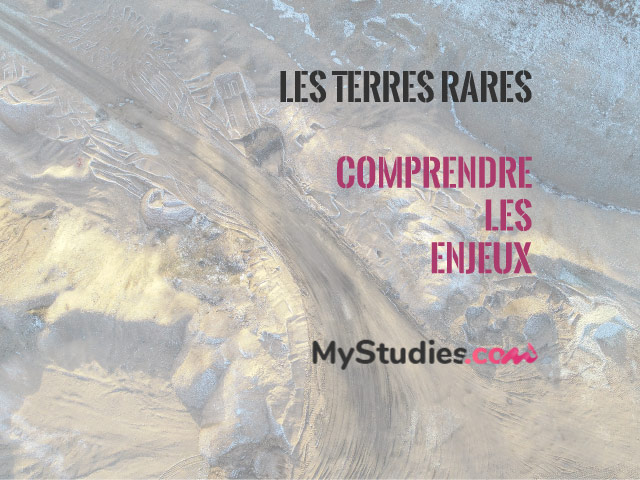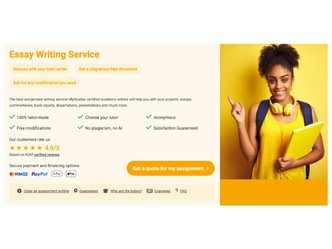Suite à l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis d’Amérique, l’Ukraine, qui bénéficie de l’aide militaire américaine depuis le début de l’invasion à échelle globale par la Russie, invasion qui, au tout départ, avait commencé avec le soutien de la rébellion séparatiste notamment de la région de Louhansk, dont le sol est justement doté du gaz de schiste[1], ressource naturelle rare et précieuse, le nouveau chef d’État américain a souhaité conditionner cette aide à un accord sur les sources rares présentes sur le sol ukrainien. Pourquoi cet accord a-t-il tant été voulu par Donald Trump ? Pourquoi les grandes puissances s’arrachent ces ressources et terres rares ? Quels en sont les enjeux ? Nous allons expliquer tout ceci dans ce qui va suivre.
Cette fiche a été rédigée sur mesure par un tuteur rédacteur de MyStudies - faites rédiger votre dissertation sur mesure et comprenez mieux les enjeux géopolitiques !
1) L’accord entre les USA et l’Ukraine
Après la séquence à la Maison Blanche qui a fait un tollé entre Donald Trump accompagné de J. D. Vance , et Volodymyr Zelensky , les deux chefs d’État sont parvenus à un accord sur les ressources rares ukrainiennes le 30 avril dernier. Ainsi, les deux pays devront se partager l’investissement dans l’extraction des ressources, et, par extension, les ressources rares en question. Le sol ukrainien en est doté d’une grande partie (5% des ressources mondiales environ), mais pas autant de capacités et d’outils nécessaires pour en assurer l’exploitation. Le tout, en échange de l’aide militaire américaine, vitale pour l’Ukraine dans le contexte actuel, pays qui fait face à une invasion par la Russie, invasion devenue à échelle totale depuis plus de 3 ans. [2]
Cet accord a été jugé équitable et mutuellement gagnant par et pour les deux parties. Alimenter sa sécurité militaire et sa capacité à se battre pour l’une, s’assurer l’obtention des ressources rares pour l’autre. Cette dernière chose en est une importante pour une puissance mondiale comme les États-Unis. Pour quelles raisons ? C’est ce que nous allons expliquer dès à présent.
2) Les terres et les ressources rares : les enjeux
Les États-Unis sont aujourd’hui la première puissance économique mondiale. Il est, par exemple, bien connu qu’une bonne partie des objets électroniques et technologies que nous utilisons en France, est de production américaine. Or, afin de les produire, des ressources rares — qui, comme leur nom l’indique, sont limitées en quantité, en plus d’être inégalement réparties entre les sols nationaux ; sans pour autant que le sol américain soit le premier à en disposer — sont nécessaires.[3] Ainsi, le besoin de s’en procurer se fait sentir.
La crise énergétique que nous vivons en Europe ces dernières années, toujours étroitement liée à l’invasion de l’Ukraine et notamment à l’arrêt des fournitures du gaz par le pays-envahisseur, la force de l’énergie nucléaire observable en comparant, par exemple, la situation de la France avec celle de l’Allemagne, sortie du nucléaire il y a un peu plus de 10 ans, le prix du carburant qui monte en flèche, carburant qui est fabriqué avec le pétrole, qui est une ressource non renouvelable, en plus d’être rare ; nous montrent et nous expliquent les enjeux et l’importance des ressources naturelles, dont font partie les terres rares.
Mais à quoi correspondent ces terres et ces ressources exactement, et qu’est-ce qui peut les caractériser ? C’est ce que nous allons voir dès à présent.
3) Les terres et les ressources rares : les caractéristiques
Quand on parle des terres rares, on entend par là les sols contenant les métaux rares, qui eux sont utilisés à de multiples fins.
3. a. Répartition géographique et exploitation
Elle a pour principales caractéristiques d’être inégale à l’échelle mondiale et de ne pas être connue avec exactitude, puisqu’il s’agit de ressources parfois difficiles et longues à découvrir. Certaines sont surtout présentes dans l’extrême Nord du globe, d’autres en Asie, encore d’autres en Afrique… Cependant, les plus gros pays-détenteurs ne sont pas forcément ceux qui ont les sols les plus riches, car une force d’exploitation est nécessaire afin d’en user. Ainsi, ce sont les premières puissances économiques, à savoir la Chine, suivi des USA, qui en produisent le plus.[4] D’où la complémentarité des USA et de l’Ukraine dans l’exploitation des ressources présentes dans le sol ukrainien.
3. b. Usages
Matériaux de construction, lasers, aimants, technologies… Les choses conçues en usant de ces ressources sont nombreuses, mais surtout, indispensables pour beaucoup d’entre elles dans le monde d’aujourd’hui.[5] Mais au-delà d’une ressource de conception, ça en est une de pouvoir géopolitique. On en revient à la répartition inégale des terres rares et à l’accord américano-ukrainien évoqués précédemment, car ceci illustre bien le pouvoir de négociation et de pression qu’elles procurent à l’international.
3. c. Aléas et défis
Il y en a deux principaux : les réserves et l’impact environnemental. Ce qui est aujourd’hui sujet à controverses voire à tensions à échelle mondiale. Ainsi, une coordination doit être faite afin d’adapter le volume de la production et de l’exploitation aux réserves disponibles, de minimiser l’impact environnemental, et d’user du recyclage, chose qui permet en partie significative de répondre à ces deux défis à la fois.
Conclusion
Ainsi, l’accord passé entre les USA et l’Ukraine illustre à la fois l’importance des terres rares dans l’économie d’aujourd’hui et la force qu’elles procurent à ceux qui les détiennent dans leur sol, et à ceux qui les exploitent ; du fait de multiples et cruciales utilités de ces terres rares. D’une part, l’avantage est attribué « par la nature » (ou, parfois, par la conquête militaire) à ceux qui les détiennent, et ce de manière très différente en fonction des zones géographiques. De l’autre, à celui qui se le procure en sachant et en pouvant en user. Ces avantages pèsent beaucoup dans la force économique et géopolitique du détenteur comme du producteur exploitant. Cependant, ces terres sont limitées en volume, alors que l’impact environnemental est à limiter ; ainsi, ces défis restent à relever pour les décennies à venir.
[1] Source : https://www.ostro.org/ru/articles/slantsevyj-gaz-na-luganshhyne-yly-est-ly-rezon-v-tom-chto-zayka-sel-protokol-i142120 (publié le 05/04/2013, consulté le 06/05/2025)
[2] Source : https://www.france24.com/fr/europe/20250501-ressources-naturelles-ukraine-ce-que-l-on-sait-accord-%C3%A9tats-unis-trump (publié le 01/05/2025, consulté le 06/05/2025)
[3] Source : https://www.diploweb.com/Carte-commentee-Les-terres-rares-nouvel-enjeu-de-puissance-et-terrain-d-affrontement-strategique.html (publié le 23/10/2024, consulté le 06/05/2025)
[4] Source : https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-rare-earths.pdf (publié en janvier 2022, consulté le 06/05/2025)
[5] Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_rare#cite_ref-USGSREO_22-1 (consulté le 06/05/2025)