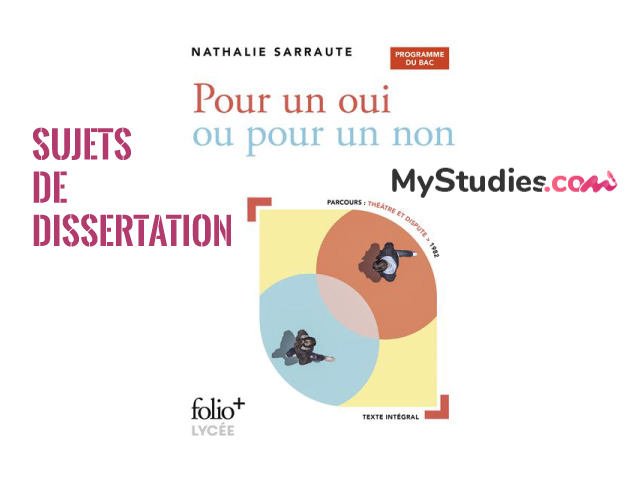Pour un oui ou pour un non, écrite par Nathalie Sarraute en 1981 et publié en 1982, explore les relations humaines à travers des dialogues tendus entre deux hommes. Leur rencontre après une longue séparation révèle les malentendus et les non-dits qui fragilisent leur relation. Ce qui frappe dans la pièce, c’est l’absence de communication claire, où silences et ambiguïtés alimentent les conflits. Sarraute nous pousse à réfléchir sur la difficulté de se comprendre vraiment dans un monde où la communication semble déshumanisée. À travers ces échanges, la pièce montre comment les non-dits génèrent des malentendus et, finalement, une rupture inévitable. Elle interroge ainsi le rôle des mots, des silences et des non-dits dans nos relations et aborde des thèmes comme la manipulation, l’isolement et la quête de sens.
Nathalie Sarraute, figure majeure du Nouveau Roman, a laissé une trace durable dans le monde du théâtre avec Pour un oui ou pour un non, une pièce épurée et tendue qui interroge la parole, l’amitié et les malentendus.
Cette œuvre peut être analysée sous plusieurs prismes différents : la manipulation dans les rapports humains, la rupture des liens humains, la quête de sens, le rôle de l’individu dans la société et le non-dit et l’ambiguïté dans la communication.
Sujet I - Peut-on parler d’une forme de tragédie dans Pour un oui ou pour un non ?
Problématique
Malgré la simplicité de l'intrigue, la pièce semble faire ressentir une tension proche de celle que l’on trouve dans les tragédies classiques. Mais peut-on vraiment parler de tragédie dans ce cadre si quotidien et minimaliste ?
Plan
I. Des éléments qui rappellent la tragédie
III. Une tragédie intérieure, propre au théâtre contemporain
Un conflit irrémédiable : une amitié détruite par quelques mots.
L’impossibilité de comprendre l’autre, malgré les efforts.
Une issue fatale : la rupture.
II. Mais une tragédie dénuée de grandeur héroïque
Pas de héros : seulement deux individus ordinaires.
Un langage quotidien, sans envolée lyrique.
La banalité de la situation : pas de destin, mais des blessures d’orgueil.
Les affects mis à nu.
L’angoisse de l’incompréhension.
Le silence plus lourd que les mots eux-mêmes.
Sujet II - Le langage est-il un outil de lien ou de rupture dans la pièce ?
Problématique
La pièce repose entièrement sur la parole. Mais celle-ci sert-elle vraiment à communiquer, ou bien crée-t-elle plutôt une distance entre les personnages ?
Plan
I. La parole comme tentative de lien
II. Mais la parole se révèle rapidement source de malentendu
III. Une réflexion sur la violence du langage
Le dialogue est constant.
H1 cherche à s’expliquer, à comprendre.
Le passé commun des deux hommes suggère un lien fort.
Un simple ton fait vaciller l’équilibre.
Les mots sont décortiqués, soupçonnés.
La communication devient impossible.
La parole comme arme sociale.
Inégalités de ton, de vocabulaire, de posture.
Le pouvoir implicite du verbe.
Sujet III - Peut-on dire que Pour un oui ou pour un non donne à voir l’invisible ?
Problématique
Avec un décor minimal, pas d’action spectaculaire et seulement deux personnages anonymes, la pièce semble chercher à montrer ce qui d’habitude échappe à la scène : les sensations, les malaises, les tensions sourdes. Est-ce là son véritable objet ?
Plan
I. Une scène épurée à l’extrême
II. Mais une tension psychologique omniprésente
III. La mise en scène d’une parole intérieure
Aucun nom, aucun lieu précis.
Pas de mouvement, pas d’intrigue.
Le vide comme décor scénique.
Le ressenti de H1 : humiliation, blessure.
Les silences, les soupirs, les hésitations.
L’écoute attentive du spectateur sollicitée.
L’espace mental devient le lieu du théâtre.
Les mots révèlent les émotions enfouies.
Une théâtralité de la pensée plus que de l’action.
Sujet IV - En quoi la pièce remet-elle en question la solidité des relations humaines ?
Problématique
Les deux personnages se connaissent depuis longtemps. Mais leur amitié s'effondre pour ce qui semble n'être qu'un détail. Sarraute cherche-t-elle à montrer que nos liens sont plus fragiles qu’ils ne le paraissent ?
Plan
I. Une amitié mise à mal par l’insignifiant
II. L’amitié révélée comme asymétrique
III. Un regard lucide et pessimiste sur le lien humain
Le "C’est bien, ça" vécu comme une attaque.
L’importance du ton, de l’attitude.
Les attentes non dites entre amis.
H2 semble distant, supérieur.
H1 plus sensible, en attente de reconnaissance.
Le malentendu comme symptôme d’un déséquilibre.
Le vernis social qui craque.
L’illusion d’une compréhension mutuelle.
L’amitié comme fragile construction symbolique.
Sujet V - Nathalie Sarraute fait-elle de sa pièce une critique des rapports de pouvoir ?
Problématique
À travers un échange tendu entre deux amis, Sarraute semble montrer comment des rapports de force se nouent dans le langage. La pièce est-elle une critique des dominations implicites dans nos relations ?
Plan
I. Une relation en apparence égalitaire
Deux amis, sans hiérarchie affichée.
Un souvenir commun.
Un cadre simple.
II. Mais des signes de domination apparaissent
III. Le théâtre comme lieu d’analyse du pouvoir symbolique
Le "ton" condescendant de H2.
H1 se sent rabaissé, jugé.
L’usage de certains mots comme moyen de prise de pouvoir.
Le langage comme champ de bataille.
Les rapports sociaux infiltrés dans les mots.
Une réflexion sur la violence invisible des rapports humains.
Sujet VI – La rupture des liens humains : entre nécessité et fatalité
Problématique
De quelle manière la rupture est présentée dans la pièce et quelle place prend-elle ?
Suggestion de plan :
I – Une rupture inévitable
A – Les malentendus accumulés
Cette partie traitera de comment les petites incompréhensions entre les personnages mènent progressivement à la rupture.
B – Les véritables raisons de la séparation
Cette partie traitera de ce qui motive réellement cette rupture, dévoilé à travers les échanges.
II – La rupture comme symptômes d’un monde sans liens véritables
A – La fragilité des relations humaines
Cette partie traitera de comment la pièce montre que les liens sont fragiles, prêts à se briser pour un malentendu.
B – La rupture comme forme de libération
Cette partie traitera de comment la rupture peut-elle offrir aux personnages une forme de liberté, bien qu’elle soit douloureuse.
Sujet VII – La quête de sens
Problématique
De quelle manière la pièce met-elle en lumière la recherche de sens à travers les dialogues entre les personnages ?
Suggestion de plan :
I – Les mots, sources de confusion
A – Un langage flou
Cette partie traitera de comment les dialogues sont pleins de malentendus, de répétitions et de phrases qui ne mènent nulle part. Les mots, au lieu de clarifier, semblent aggraver la confusion.
B – Les silences et hésitations
Cette partie traitera de ces moments d’absence de mots ajoutent à l’incertitude et à la quête de sens, créant un vide où il devient difficile de comprendre quoi que ce soit.
II – Les personnages dans leur propre tourbillon d'incertitude
A – Le désir de comprendre, l'incapacité à communiquer
Cette partie traitera de comment les hommes restent bloqués dans leurs interprétations personnelles, incapables de vraiment se comprendre alors même qu’ils essaient de se parler
B - Une vérité qui échappe toujours
Cette partie traitera de comment les deux personnages sont constamment à la recherche d’une vérité, mais elle semble toujours leur échapper, comme si leurs dialogues étaient destinés à tourner en rond sans jamais atteindre une conclusion claire.
Sujet VIII – Le rôle de l’individu dans la société : une réflexion sur l’isolement
Problématique
De quelle manière la pièce critique-t-elle l’individualisme et l’isolement de la société moderne ?
Suggestion de plan :
I – L’individualisme comme cause de l’isolement
A – La solitude malgré l’échange
Cette partie traitera de comment les hommes se retrouvent, mais restent chacun enfermés dans leur propre monde, incapables de se comprendre véritablement.
B – L'impact de la société moderne
Cette partie traitera de comment les relations deviennent superficielles, renforçant leur isolement au lieu de créer de véritables liens, dans un monde où l’individualisme prime,
II – La défaillance de la communication comme symptôme de l’isolement social
A – L’incapacité à se connecter
Cette partie traitera de comment la communication échoue continuellement, ce qui montre l'isolement psychologique et social qui les sépare.
B – Une société qui déconnecte
Cette partie traitera de comment la pièce semble aussi critiquer une société qui empêche les individus de se comprendre et de créer des relations authentiques, rendant l’isolement presque inévitable.
Sujet IX – Le non-dit et l’ambiguïté dans la communication
Problématique
De quelle manière le non-dit contribue-t-il au développement du drame dans cette pièce ?
Suggestion de plan :
I – Le non-dit comme source de tension
A – Les silences et les sous-entendus
Cette partie traitera de comment dans la pièce, il y a des moments où les personnages retiennent leurs mots, et ces non-dits créent une tension qui pèse lourdement sur leurs échanges.
B – Un passé qui reste en suspens
Cette partie traitera de comment beaucoup de choses ne sont pas dites, mais elles sont là, sous la surface, à cause de leur passé commun, et cela influence leur comportement sans en parler ouvertement.
II – Les malentendus provoqués par les non-dits
A – Des échanges mal compris
Cette partie traitera de l'absence de communication claire engendrant des malentendus, parfois presque drôles, mais souvent plus graves et tragiques.
B – Le non-dit comme protection
Cette partie traitera de comment les personnages choisissent parfois de ne rien dire pour se protéger du rejet ou d’une confrontation directe, ce qui alimente encore plus leur incapacité à se comprendre.
Conclusion
En résumé, Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute explore la complexité des relations humaines dans un monde où l’incommunicabilité domine. À travers les dialogues entre deux hommes, l’auteure met en lumière la difficulté de se comprendre et l’importance des non-dits. Les silences et malentendus, loin d’être secondaires, alimentent le drame et révèlent la fragilité des liens humains. La pièce critique subtilement l’individualisme et l’isolement de notre société, où la communication semble souvent impossible. En fin de compte, Sarraute nous pousse à réfléchir sur la difficulté de comprendre l’autre dans un monde marqué par la rupture et l’incompréhension.
Sources et références utiles
Commentaire composé, pour un oui ou pour un non, fiche de lecture, Amélie Vioux
Kartable, pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute
Résumé de Pour un oui ou pour un non de Sarraute, résumé et présentation, bac de français 2025, publié le 11 novembre 2024 par la boîte à Bac
Sarraute, Nathalie. Pour un oui ou pour un non, Gallimard, 1982.
Jean-Yves Tadié, Le roman au XXe siècle, Folio Essais.
Jean-Pierre Sarrazac, L’Avenir du drame, Actes Sud, 1999.
Articles critiques sur le site de Théâtre contemporain.net