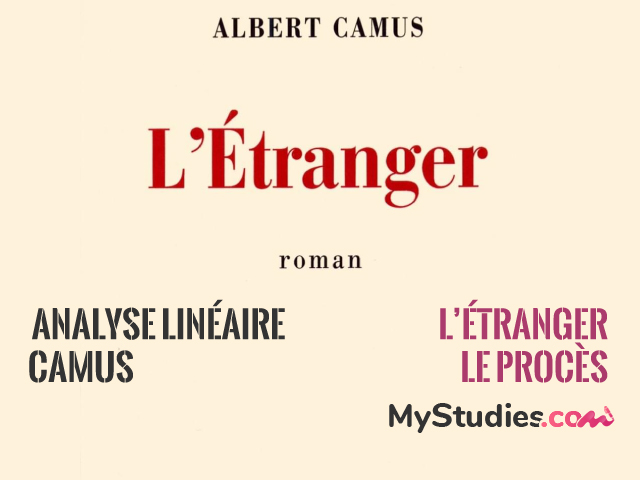I. La problématique et les mouvements du texte
Comment la dérision de la justice fait-elle de Meursault un étranger à son propre procès ?
Le premier mouvement du texte permet de montrer la satire de la justice.
Le deuxième mouvement révèle un personnage étranger à son portrait.
Le troisième mouvement dévoile les souvenirs et les sensations du personnage.
II. Analyse linéaire
● La satire de la justice
Tout d’abord, Camus entame la satire de la justice en enlevant le caractère humain et individuel des personnages autour de Meursault. En effet, l’antithèse entre les termes “grands ventilateurs” et “petits éventails” met en avant un certain mimétisme mécanique des membres du jury. Cette opposition permet dans un premier temps de réduire l’importance des “jurés” en raison de la différence entre les “éventails” et les “ventilateurs”, mais dans un deuxième temps de montrer le caractère idiot de l’expression “brassaient l’air”. De plus, la généralisation des personnages à travers leur profession permet de remarquer une présentation très brève et stéréotypée, notamment avec l’expression “Tous les avocats font ça”. Sur ce point, la distinction entre les paroles rapportées du gendarme et l’interrogation indirecte de Meursault montre l’effacement de ce dernier en faveur des échanges des autres. Le narrateur semble alors entouré à ce moment-là de personnes qui ne se souciaient en fait plus réellement de lui.
Pour montrer la défense de Meursault de façon caricaturale, la plaidoirie est d’abord décrite comme étant longue, on peut notamment le percevoir à travers les passages “la plaidoirie me semblait ne jamais devoir finir” et “toutes ces longues phrases”. Ils insistent, d’une part, sur l’effort fourni par l’avocat, et, d’autre part, sur l’absurdité de la défense du personnage de Meursault. En effet, la description que l’avocat propose de son client est élogieuse, avec par exemple le chiasme “un honnête homme, un travailleur régulier” et l’accumulation des adjectifs “infatigable”, “fidèle”, “aimé” et “compatissant”. Cela ne correspond en rien au personnage concerné, bien au contraire. Ici, il s’agit de montrer l’hypocrisie et le devoir de défense de l’avocat, quel que soit son client.
Meursault est mis à l’écart par son avocat lorsque ce dernier évoque le récit de son client à la première personne du singulier comme avec l’aveu “Il est vrai que j’ai tué”. Ce parti pris est confirmé par le gendarme, après quoi le narrateur exprime son ressenti à travers le discours indirect “il m’a dit de me taire” et l’hyperbole “me réduire à zéro”. Progressivement, le personnage se rend compte qu’il se sent étranger à ce qui est en train de se dérouler.
● Un personnage étranger à son portrait
Lors du récit de son avocat, Camus utilise le regard de Meursault pour montrer le décalage entre son portrait et ses pensées.Tout d’abord, il porte un jugement sur mon avocat avec l’expression “mon avocat m’a semblé ridicule”. L’alternance entre le discours direct de l’avocat et le discours indirect nous permet de passer d’une parole à son interprétation, notamment avec les expressions “Il y avait lu” et “Pour lui”. L’opposition entre ce que dit l’avocat et la réalité est indiquée par les pensées de Meursault à travers différentes antithèses comme “maison de retraite” et “asile”, “sa mère” et “la vieille femme”. C’est à travers ces considérations que l’absence d’émotions du narrateur se dévoile, et donc que sa culpabilité n’est pas surprenante. L’absence de la mention de l’enterrement permet à Camus de montrer que Meursault ironise sur l’inutilité de tout ce qui peut être dit qui ne concerne pas le crime en particulier. En effet, l’antiphrase “et j’ai senti que cela manquait dans sa plaidoirie” montre à nouveau le sentiment de décalage entre la défense de l’avocat et son efficacité.
L’alternance entre le discours direct et la narration permet également de montrer une écoute entrecoupée du principal intéressé. Camus insiste pour cela sur la durée de l'audience avec le parallélisme “à cause de toutes ces longues phrases, de toutes ces journées” qui lui-même se trouve dans l’accumulation qui se poursuit jusqu’aux “heures interminables”. Afin de confirmer que Meursault ne se reconnaît pas dans le portrait qui est fait de lui, la proposition subordonnée circonstancielle “pendant lesquelles on avait parlé de mon âme” insiste sur le sophisme de l’avocat. Enfin, Camus illustre le moment où son narrateur quitte mentalement la scène à travers la comparaison “j’ai eu l’impression que tout devenait comme une eau incolore où je trouvais le vertige”. Cette expression permet à l’auteur de montrer l’absence de la logique dans cette plaidoirie.
● Les souvenirs et les sensations du personnage
La position de Meursault en tant qu’observateur de la scène permet tout au long de l’extrait de marquer la théâtralité de laquelle il se moque, en particulier lorsqu’il va ensuite se mettre à penser à autre chose. La narration reste donc largement objective jusqu’à l’apparition soudaine de ses souvenirs. L’hyperbole “j’ai été assailli” montre que les souvenirs font enfin réagir Meursault émotionnellement. Ses souvenirs persistent à l’isoler, on peut le voir avec la proposition subordonnée relative “une vie qui ne m’appartient plus”. Ses seules “joies” sont “les plus pauvres et les plus tenaces”, l’utilisation du superlatif “les plus” permet d’insister sur une forme de vide émotionnel dans sa vie.
Les souvenirs évoqués font références aux sens, comme l’ouïe avec la métonymie “la trompette d’un marchand de glace a résonné jusqu’à moi”. Ces souvenirs qui refont surface amènent le narrateur à enfin laisser s’exprimer son âme, on le voit à travers l’accumulation “des odeurs d’été, le quartier que j’aimais, un certain ciel du soir, le rire et les robes de Marie”. L’adjectif “inutile” pour qualifier ce “tout” implique ici le manque de considération que le narrateur s’accorde à lui-même. Sa condamnation devient alors une solution pour retrouver une forme de sérénité “je n’ai qu’une hâte, c’est qu’on en finisse et que je retrouve ma cellule avec le sommeil”. L’antithèse hyperbolique “le plus sûr de mes châtiments” confirme effectivement l’idée selon laquelle la condamnation est, d’une part, justifiée et, d’autre part, l'échappatoire de Meursault. La fatigue du narrateur et de son avocat se font ressentir ensemble, mais ce qui les oppose restent l’optimisme vain d’un avocat qui ignore et renie la nonchalance pessimiste de son client.